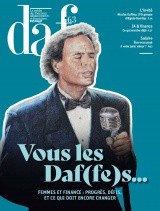Dividende sociétal, cet outil financier novateur du partage de la valeur
Rencontre avec Eric Delannoy, auteur du livre Le dividende sociétal, paru ce mercredi 9 avril aux éditions Dunod. Un échange inspirant sur la façon dont les dirigeants et les Daf pourraient s'emparer de la question devenue centrale aujourd'hui du partage de la valeur créée par l'entreprise, et son enjeux de transformation sociétale.

Comment avez-vous eu l'idée de consacrer un livre au « dividende sociétal » ?
Eric Delannoy : En tant qu'économiste de formation, j'observe que nous vivons dans une société où les prélèvements obligatoires atteignent un niveau record au niveau mondial, tout comme la dépense publique. Pourtant, malgré cette mobilisation massive de ressources, les fractures sociales persistent et l'insatisfaction générale demeure forte.
Dès lors, une question fondamentale se pose : comment générer davantage de moyens pour répondre aux enjeux du bien commun, sans pour autant recourir à une nouvelle hausse des impôts ? Il existe des leviers alternatifs, comme le mécénat, qui repose sur l'appel à la générosité et à la responsabilité. Mais nous n'en avons pas encore exploité tout le potentiel. Par ailleurs, en tant qu'entrepreneur, je suis convaincu que les entreprises ont un rôle politique à jouer. Elles sont au coeur des dynamiques sociales et environnementales.
Qu'entendez-vous par « dividende sociétal » ?
E. D. : Le livre « Dividende Sociétal » n'est pas un manifeste théorique ou académique, mais le fruit d'une expérience concrète. À travers mon entreprise engagée Tenzing, nous avons voulu casser deux codes structurants de notre secteur : le recrutement élitiste et un partage très inégalitaire de la valeur. Nous recrutons sur la compétence plutôt que sur le diplôme - la moitié de nos consultants n'auraient jamais été retenus par les cabinets traditionnels - et nous avons fait le choix fort de céder 70 % de notre capital à une association à but non lucratif, afin que les dividendes soient reversés à des causes d'égalité des chances.
Ce modèle prouve deux choses. Premièrement, la mixité sociale est compatible avec l'excellence intellectuelle. Deuxièmement, il est possible de transformer les règles d'un secteur, même très normé. Ce livre est un appel à repenser les règles du capitalisme, non pour le rejeter, mais pour en faire un levier au service du bien commun.
Pourquoi avoir associer deux termes antinomiques comme « dividende » et « société » ?
E. D. : Il n'existe d'oxymore que pour qui souhaite en voir un. Le « dividende », dans sa définition classique, incarne la rémunération du capital et constitue l'un des fondements du capitalisme, en récompensant le risque assumé par l'investisseur. Le « sociétal », quant à lui, renvoie à tout ce qui relève du vivre-ensemble, de la cohésion sociale. Ces deux notions ne s'opposent pas : elles sont, au contraire, intrinsèquement liées.
Pour qu'un dividende puisse être versé, il est nécessaire de générer de la valeur. Or, cette création de valeur repose sur la transformation du capital et du travail, éléments indissociables du tissu social.
C'est un concept qui questionne le modèle de l'entreprise ?
E. D. : L'idée selon laquelle l'entreprise créerait la richesse pendant que l'État réparerait ses externalités est dépassée. Je pense que les entreprises ont une responsabilité directe vis-à-vis des impacts sociaux et environnementaux qu'elles génèrent.
Ainsi, plus une entreprise est prospère, plus elle est légitime à redistribuer une part de sa richesse à ceux qui ont contribué à sa performance : en premier lieu, ses collaborateurs. La rémunération salariale, l'épargne salariale ou la protection sociale sont autant de mécanismes de partage de la valeur, qui participent à la motivation des équipes et, in fine, à une plus grande productivité.
Le dividende sociétal repose sur un choix de temporalité. Il ne s'agit pas de renoncer à la performance, mais de consentir à partager une part de la richesse à court terme, dans l'objectif de consolider un écosystème plus stable, plus inclusif et plus durable, garant de prospérité à long terme. C'est là tout le sens de cette démarche.
Comment le dirigeant, et le Daf, peuvent-ils adopter ce mécanisme novateur de mécénat ?
E. D. : Il existe une méthode rigoureuse pour mettre en oeuvre un dividende sociétal en s'appuyant sur les outils comptables existants, sans en inventer de nouveaux. Première étape fondamentale : l'accord entre les dirigeants et les actionnaires, préalable indispensable à toute répartition différente de la valeur créée.
Le dividende sociétal ne remet pas en cause la logique classique de partage du bénéfice net - entre les salariés (via l'intéressement ou la participation), l'entreprise elle-même (via le report à nouveau) et les actionnaires (via les dividendes). Il propose simplement d'ajouter un nouvel acteur à cette répartition : les parties prenantes silencieuses, c'est-à-dire la société au sens large (environnement, associations, équité sociale, etc.)
Concrètement, il s'agirait de prélever une part des bénéfices destinés aux actionnaires pour financer des engagements d'intérêt général. Ce processus s'apparente en partie au mécénat, mais va plus loin que les simples actions ponctuelles ou symboliques. Le dividende sociétal devient un levier stratégique structuré, incarnant la place que souhaite occuper l'entreprise dans la société. La direction financière joue ici un rôle central, aux côtés des directions RSE, notamment dans le cadre du reporting extra-financier imposé par la CSRD. Le dividende sociétal, en mobilisant des données financières et RSE déjà disponibles, s'intègre de manière fluide dans l'architecture comptable actuelle, et permet de poser une question essentielle : à qui redistribuer la richesse créée, une fois toutes les obligations remplies ?
Justement, quelles différences comptables avec le dividende « classique » ?
E. D. : Pour un directeur administratif et financier, la notion de dividende sociétal ne présente, à ce jour, aucune spécificité comptable. Elle repose sur une simple décision de réallocation d'une partie du bénéfice net, sans régime fiscal dédié. Dans la conclusion du livre, je propose même la création d'un régime fiscal spécifique, analogue à celui du
Mécénat, une défiscalisation de 60 % de l'ensemble du dividende sociétal, calculée non plus sur le chiffre d'affaires, mais sur la part du résultat net consacrée à des projets d'intérêt général. Cette logique s'inspirerait de celle qui fonde la fiscalité avantageuse de l'intéressement et de la participation, considérés comme des redistributions au profit du collectif salarié. Le dividende sociétal, quant à lui, viserait à rémunérer les parties prenantes silencieuses - autrement dit, la société dans son ensemble. Point important, ces investissements sociaux ou environnementaux réalisés par les entreprises représenteraient autant de coûts évités pour la puissance publique, légitimant une réduction d'impôt.
Vous citez l'exemple du Crédit Mutuel, pouvez-vous expliquer les enjeux pour la banque ?
E. D. : Lorsqu'une entreprise comme le Crédit Mutuel choisit d'offrir des services bancaires gratuitement à des associations, cela s'apparente à une forme de dividende sociétal, dans la mesure où l'activité n'est pas génératrice de profit, mais orientée vers le bien commun.
Toutefois, pour que cette démarche soit comptablement traçable, il est nécessaire de mettre en place un système analytique adapté. Celui-ci doit permettre d'identifier la part de l'appareil productif mobilisée, de la valoriser de manière transparente et de l'imputer explicitement à cette action non lucrative.
Cette approche suppose donc une mécanique financière spécifique, fondée sur des méthodes de valorisation existantes, qui permettent de distinguer une poche d'activité volontairement non margée, dédiée à une finalité d'intérêt général.
Les modèles « mutualistes » sont-ils plus adaptés à ce type de mécénat ?
E. D. : Le directeur financier d'une banque mutualiste, comme le Crédit Mutuel, utilise les mêmes outils et méthodes comptables qu'un Daf d'une banque classique. La différence ne réside donc pas dans la mise en oeuvre technique du dividende sociétal - qui repose sur des mécanismes financiers standards - mais dans la décision stratégique préalable. Dans une structure mutualiste, l'absence d'actionnaires facilite cette décision, puisqu'il n'y a pas de conflit d'intérêt autour de la répartition des bénéfices.
Ainsi, le véritable enjeu réside dans l'accord préalable entre dirigeants et actionnaires, ces derniers devant accepter de renoncer à une part de dividende au profit d'actions à visée sociétale. Si les acteurs mutualistes ont été les premiers à s'approprier cette logique, il est intéressant de constater que le terme même de « dividende » - historiquement lié à la logique capitaliste - est aujourd'hui revendiqué par des structures non actionnariales, dans une volonté d'élargir ce modèle au service du bien commun.
Sur le même thème
Voir tous les articles Gouvernance & Stratégie