CSRD : quels impacts du report sur les entreprises de la vague 2 ?
La loi Omnibus 1 a été adoptée par la Commission européenne le 3 avril dernier. Bien que cette décision ait été prise pour offrir un répit aux entreprises de la vague 2 et 3 face aux charges administratives, ses effets pourraient être contre-productifs. Décryptage avec Amandine Duquesne, associée RSE et Finance durable chez RSM, réseau mondial d'audit et de conseil.

Où en sont les entreprises de la vague 2 ?
Amandine Duquesne : Notre portefeuille de clients est composé essentiellement d'entreprises concernées par la deuxième vague. Avec les récents ajustements calendaires, nous observons une phase de temporisation de la part de plusieurs entreprises de la vague 2, notamment en ce qui concerne la désignation d'un auditeur de durabilité. Cette mise en attente ne signifie pas un abandon du sujet. Nombre d'entre elles, déjà engagées dans la préparation de leur conformité à la CSRD, poursuivent leurs travaux avec détermination, convaincues que la performance extra-financière ne peut être reléguée au second plan.
Comment se préparent-elles ?
A. D. : Ces entreprises s'orientent davantage vers des missions de revue critique, ciblées et sur-mesure. Certaines sollicitent un examen des seuls indicateurs quantitatifs, d'autres concentrent l'analyse sur des référentiels spécifiques (environnement, gouvernance, double matérialité), ou bien demandent une revue complète du reporting.
Ce format « à la carte » traduit une évolution salutaire, au-delà des contraintes réglementaires, les entreprises commencent à se réapproprier la démarche extra-financière. Elles y voient de plus en plus un outil de pilotage stratégique, et non plus seulement un exercice de conformité.
Quels sont les principaux changements qui s'opèrent pour vous ?
A. D. : Nous revenons à une vision plus fondatrice de la RSE, celle d'un levier volontaire de transformation, qui dépasse la simple production d'un rapport conforme. Cet élan nouveau marque un tournant, où la durabilité devient un vecteur intégré de performance, au coeur des réflexions financières, opérationnelles et stratégiques de l'entreprise.
Nous avons partiellement ajusté notre approche stratégique, dans l'attente des précisions définitives apportées par l'Omnibus qui viendra clarifier le périmètre des datapoints supprimés ou allégés. Il serait prématuré, pour une entreprise, de publier dès à présent une information exhaustive sur l'ensemble de ses sujets dits matériels, alors même que certains pourraient, à court terme, ne plus être considérés comme tels. Pour autant, il convient de ne pas aborder cette évolution uniquement sous l'angle de la contrainte réglementaire ou de la suppression des obligations de reporting. Ce moment de transition offre au contraire l'opportunité de recentrer les réflexions sur la matérialité réelle des enjeux, et donc sur la pertinence stratégique des sujets traités.
Avez-vous identifié des freins par rapport aux investisseurs ?
A. D. : Effectivement, les entreprises aujourd'hui les plus réticentes à s'engager dans la démarche extra-financière étaient déjà, pour beaucoup, celles les moins avancées sur ces sujets avant même l'annonce du report lié à la vague 2 de la CSRD.
Or, cet attentisme comporte désormais de réels risques stratégiques, notamment dans un contexte où ces mêmes entreprises sont en recherche de financements ou d'investissements, les conduisant à dialoguer avec des banques, investisseurs ou partenaires financiers qui, eux, n'ont en rien revu à la baisse leurs exigences ESG depuis Omnibus.
Aujourd'hui, il est question de « KPI ESG » dans les crédits syndiqués, de « critères extra-financiers » exigés par les grands donneurs d'ordre. En choisissant de se mettre en retrait, ces entreprises prennent le risque de se fermer l'accès à certaines sources de financement et de se marginaliser dans des chaînes de valeur où l'information extra-financière reste attendue et scrutée.
Reporter l'effort sous prétexte d'un délai réglementaire revient à adopter une vision à très court terme, en ignorant que d'autres acteurs, soumis ou non à la réglementation, ont choisi de poursuivre activement leur trajectoire ESG. Ces derniers continueront à communiquer, à se structurer et à progresser, renforçant ainsi leur attractivité et leur avantage concurrentiel. Les entreprises qui ne saisissent pas cet enjeu risquent donc non seulement de prendre du retard, mais surtout de ne pas pouvoir le rattraper.
Y-a-t-il un risque concurrentiel pour ces entreprises qui retardent l'échéance ?
A. D. : Il est aujourd'hui manifeste que les marchés publics intègrent systématiquement des clauses ESG obligatoires dans leurs cahiers des charges. Cette exigence n'est pas nouvelle et ne dépend pas uniquement du calendrier réglementaire. À titre d'exemple, plusieurs de nos clients implantés en Europe, mais dont la consolidation financière est opérée hors Union européenne ont très tôt exprimé leur volonté de ne pas attendre leur date d'éligibilité à la CSRD pour engager une démarche de communication sur leurs performances ESG.
Ce positionnement pragmatique traduit une prise de conscience des risques économiques et concurrentiels liés à l'inaction. Dans l'ensemble de la chaîne de valeur, les attentes sont déjà présentes : les donneurs d'ordre exigent des preuves tangibles d'engagement RSE, les appels d'offres imposent des critères de durabilité, et certains clients sollicitent des évaluations ESG formelles. Si le report de la CSRD décale la production obligatoire d'un rapport standardisé, il ne supprime en rien l'exigence de transparence sur les pratiques et les performances ESG. Les entreprises qui croiraient pouvoir faire l'économie d'un tel effort dans l'intervalle s'exposent à un réel désavantage compétitif.
Avez-vous l'impression que le niveau d'exigence européen en matière de ESG recule ?
A. D. : Il existe en effet un risque que le niveau d'exigence initialement porté par l'Union européenne en matière de durabilité soit, dans une certaine mesure, revu à la baisse. Toutefois, il convient de conserver une approche lucide. Des signaux internationaux forts viennent rappeler la pertinence du cadre européen.
La Chine, par exemple, vient tout juste de publier ses propres lignes directrices alignées sur les principes de la double matérialité, socle central de la CSRD.
Lire aussi : Directive "suspensive" : le Conseil européen avance vers une simplification réglementaire de la CSRD
Ces évolutions démontrent que l'Europe n'était sans doute pas éloignée d'une démarche méthodologiquement juste, et qu'il serait dangereux de relâcher la dynamique sous peine de subir, tôt ou tard, des pressions ou des exigences émanant d'autres organisations ou zones économiques.
Le contexte géopolitique et diplomatique actuel, marqué par une certaine instabilité, contribue à reléguer la RSE au second plan, notamment dans les priorités exprimées par les dirigeants d'entreprises. Cette tension illustre le tiraillement permanent entre une logique de court terme, dictée par les impératifs de compétitivité, de rentabilité ou même de survie économique, et une logique de long terme inhérente aux enjeux de durabilité. Toute la difficulté réside aujourd'hui dans la recherche d'un juste équilibre, d'un curseur pertinent entre ces deux horizons temporels, sans sacrifier l'un au profit de l'autre.
Comment se situent les entreprises françaises dans ce contexte ? Elles étaient réputées être « en avance » en matière de RSE ?
A. D. : La France fait preuve d'une maturité avancée en matière de reporting extra-financier par rapport à d'autres pays. Cette avance s'explique notamment par une tradition bien ancrée de vérification des données extra-financières, mise en oeuvre depuis plusieurs années. Elle reflète une culture socio-économique où la cohérence entre les engagements pris et leur mise en oeuvre est valorisée.
Dans ce contexte, l'arrivée de la CSRD et des normes ESRS, bien qu'exigeantes, ne représente pas un bouleversement complet pour nombre d'acteurs français. Sur plusieurs volets, notamment environnementaux, les indicateurs demandés sont déjà partiellement suivis par les entreprises via d'autres cadres réglementaires ou pratiques existantes (bilan carbone, réglementation REACH, certificats énergétiques, etc.). Le véritable enjeu réside davantage dans la structuration et la mise en qualité des données. Autrement dit, la France aborde cette nouvelle phase avec une base solide, fruit d'une culture de la conformité et du pilotage déjà bien établie.
Ce décalage est-il favorable aux investissements de la finance durable ?
A. D. : Les investisseurs à impact ont en effet l'ambition d'associer performance financière et contribution positive à des enjeux environnementaux ou sociaux. Toutefois, dans le contexte actuel, marqué par une certaine instabilité géopolitique et géoéconomique, cet investissement responsable connaît un léger ralentissement, malgré son caractère indéniablement vertueux.
Un des défis majeurs reste l'hétérogénéité des objectifs d'impact définis par les différents fonds ou investisseurs, ces derniers affichant des niveaux d'exigence parfois très variables. En ce sens, la réglementation européenne SFDR, notamment à travers les classifications Article 8 et Article 9, constitue une avancée structurante. Elle permet non seulement de mieux aligner les pratiques, mais aussi de redonner de la crédibilité et de la clarté à l'investissement à impact. Il ne s'agit plus simplement d'intégrer quelques indicateurs ESG dans un contrat, mais bien de s'inscrire dans une démarche cohérente et exigeante d'investissement responsable.
Sur le même thème
Voir tous les articles Finance durable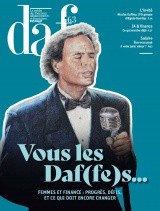

![CSRD : premiers retours d'expériences d'entreprises qui [...]](https://cdn.edi-static.fr/image/upload/c_lfill,h_201,w_298/e_unsharp_mask:100,q_auto/f_auto/v1/Img/BREVE/2025/4/471892/csrd-premiers-retours-experiences-entreprises-publient-2025-L.jpg)








